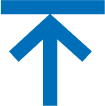Disputes de voisinage, nuisances sonores, conflits autour des travaux ou encore démêlés avec le syndic... Vivre en copropriété peut générer des tensions entre résidents. Face à ces situations qui perturbent la tranquillité collective, la médiation émerge comme une réponse efficace. Cette approche alternative aux tribunaux offre rapidité et économies. Comment gérer les litiges grâce à la médiation en copropriété ?
Hellio aide les copropriétaires à mener sereinement des travaux
Comment fonctionne la médiation ?
Selon la définition du Ministère de la Justice, « La médiation est un mode amiable de règlement des différends (MARD) qui peut permettre d’aboutir à une solution plus rapidement qu’en saisissant la justice ». Un différend en copropriété peut donner lieu à une médiation.
Les copropriétaires disposent de deux options principales :
- La médiation judiciaire : proposée ou ordonnée par un juge ;
- La médiation conventionnelle : démarche volontaire des parties.
La médiation judiciaire
Lorsqu'un magistrat examine un litige, il peut suggérer aux parties d'explorer cette voie avant de rendre sa décision. La procédure s'étend sur trois mois au maximum, avec possibilité de prolongation jusqu’à six mois si les circonstances l'exigent.
Depuis 2019, les juges bénéficient d'un mécanisme renforcé : ils peuvent contraindre les parties à rencontrer un médiateur pour une séance d'information. Cette rencontre, fréquemment organisée à distance, constitue une mesure administrative non susceptible d'appel. Une mesure administrative non susceptible d'appel est une décision prise par l'administration qui ne peut pas être réexaminée par une juridiction supérieure par la voie de l’appel. Cela signifie qu’elle est rendue en dernier ressort, bien qu’un pourvoi en cassation puisse parfois être envisagé devant le Conseil d’État.
La médiation conventionnelle
Cette modalité s'épanouit hors du cadre judiciaire traditionnel. Les participants définissent librement la temporalité de leur démarche dans un accord préalable. Cette souplesse s'avère précieuse pour traiter des situations complexes nécessitant un délai supérieur aux six mois réglementaires.
Les principes fondamentaux
Trois éléments conditionnent la réussite du processus :
- L'adhésion volontaire demeure primordiale : contraindre une partie compromettrait irrémédiablement l'efficacité des échanges ;
- La discrétion absolue protège ensuite les discussions : aucune révélation n'est permise sans autorisation expresse des participants ;
- L'impartialité du médiateur garantit enfin l'équité du processus.
LE CHIFFRE HELLIO : ¾ des médiations aboutissement sur un accord
Trois médiations judiciaires sur quatre aboutissent à un accord (75,2 %), dont 61,5 % à un accord total et 13,7 % à un accord partiel, selon le Ministère de la Justice. Ces accords sont généralement rédigés par écrit (78 % des cas) et le plus souvent par un avocat.
Quel est le rôle du médiateur ?
Loin d'incarner un arbitre ou un décideur, le médiateur facilite la communication entre des personnes souvent en froid depuis de longs mois.
Un professionnel aux compétences particulières
L'objectivité représente l'exigence première de cette fonction. Le praticien évite soigneusement tout favoritisme, jugement hâtif ou position partiale. Cette neutralité bienveillante instaure la confiance nécessaire aux négociations constructives.
L'autonomie constitue le second fondement de son intervention. Résistant aux influences externes et aux pressions diverses, il préserve son jugement des interférences potentielles.
Des approches variées selon les contextes
Le professionnel adapte ses méthodes aux spécificités de chaque conflit. Assemblées générales pour exposer les divergences, entrevues privées pour approfondir les motivations individuelles, consultation d'experts spécialisés selon les besoins... Cette flexibilité contraste avec la rigidité des procédures d’un tribunal.
Pour les situations particulièrement épineuses, l'intervention d'un second médiateur ou d'un consultant technique enrichit l'analyse et multiplie les perspectives de résolution.
La question financière
Contrairement aux conciliateurs municipaux qui officient gracieusement, les médiateurs facturent leurs services. Leurs émoluments, aux alentours de 250 euros par heure, se partagent équitablement entre les parties sauf arrangement contraire.
Qui peut saisir un médiateur ?
Tous les occupants de la copropriété peuvent initier cette démarche selon leurs besoins.
Les copropriétaires directement concernés
Confrontés quotidiennement à des difficultés, les résidents peuvent proposer cette solution à leurs voisins lors de désaccords variés. Ce sont souvent les travaux qui génèrent des mécontentements : budget des interventions, répartition des coûts, planning d'exécution ou désagréments temporaires.
Les conflits de voisinage offrent également un terrain propice à cette approche. Tapage nocturne ou diurne, usage inapproprié des espaces collectifs... autant de situations peuvent impliquer le recours à un médiateur.
Vos travaux de rénovation avec un partenaire de confiance
Le syndic, un médiateur naturel ?
L’INFO HELLIO
Depuis 2020, la réglementation impose une démarche amiable préalable pour certaines catégories de différends : montants inférieurs à 5 000 euros ou lors d’un conflit de voisinage.
Responsable du respect du règlement de copropriété, le syndic de copropriété occupe une position centrale dans la prévention et le traitement des tensions. Avant d'entreprendre des démarches contentieuses, il peut suggérer cette alternative aux parties concernées.
Cette stratégie présente un double bénéfice : maintenir la sérénité au sein de l’immeuble tout en évitant des procédures onéreuses et chronophages.
À lire aussi : Parties communes en copropriété : définition, règles et gestion
Quand et comment saisir un médiateur ?
Quel est le bon moment pour avoir recours à la médiation ?
L'efficacité de la démarche dépend largement du timing choisi. L'idéal consiste à agir dès l'apparition des premières crispations. Il est plus facile de résoudre un malentendu naissant que de laisser le conflit s’envenimer.
Si les tentatives directes échouent, une sommation formelle peut précéder la médiation.
Le processus demeure envisageable même après l'engagement d'une action judiciaire. Magistrats et conseils peuvent recommander cette voie à tout stade de la procédure.
Les modalités de saisine
Au moment de saisir un médiateur, le mieux reste d’identifier un praticien spécialisé dans l'immobilier, agréé par l'ensemble des participants. Une fois que l’on s’est mis d’accord, il convient de cadrer la mission. La rédaction d'un protocole précise alors les aspects pratiques :
- calendrier de rencontres,
- échéances,
- rémunération,
- règles de confidentialité.
Les participants aux séances
Les rencontres rassemblent généralement le gestionnaire, les délégués du conseil syndical et les copropriétaires en désaccord. Chaque camp peut venir accompagné de son avocat.
Le recours à une expertise technique peut aussi venir enrichir les débats, notamment pour les litiges portant sur des aspects financiers, architecturaux ou de travaux.
La formalisation de l'entente
Une fois la médiation arrivée à terme, si l’on a trouvé un terrain d’entente, c’est l’heure du compromis. Ce compromis doit être consigné par écrit et approuvé par les parties.
Dans le contexte de la médiation en copropriété, certaines dispositions nécessitent une ratification en assemblée générale, particulièrement celles engageant financièrement la collectivité ou modifiant le règlement.
Quelles autres solutions en cas de litiges ?
Lorsque la médiation s'avère inadéquate ou infructueuse, d'autres recours subsistent.
La conciliation municipale
Cette démarche gratuite, organisée dans les mairies, mobilise un conciliateur bénévole.[10] Ce volontaire formé propose des arrangements amiables, indépendamment de toute saisine judiciaire. L'inconvénient réside dans la disponibilité limitée de ces intervenants et leur impossibilité d'orienter activement les discussions.
Le recours contentieux
En dernière extrémité, l'option judiciaire demeure possible. Attention néanmoins aux délais : la loi Elan limite la prescription à cinq années pour les conflits en copropriété.
L'orientation juridictionnelle varie selon la nature du différend :
- Tribunal judiciaire pour la majorité des cas, sans plafond financier ;
- Chambres de proximité pour les petits litiges.
Ces démarches, coûteuses et lentes, méritent mûre réflexion. Leurs issues restent incertaines et risquent d'aggraver durablement les relations de voisinage.
Hellio vous conseille sur tous vos travaux pour éviter les litiges
[1] https://www.justice.fr/sites/default/files/SG-SADJAV-Mediation-Triptyque-190612-V8.pdf
[2] https://www.bjavocat.com/2023/05/31/la-mediation-en-copropriete/
[3] https://www.bjavocat.com/2023/05/31/la-mediation-en-copropriete/
[4] https://www.bjavocat.com/2023/05/31/la-mediation-en-copropriete/
[5] https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/Infos_Rapides_Justice_n12_médiateurs.pdf
[6] https://www.cotoit.fr/blog/litiges-en-copropriete/
[8] https://www.cotoit.fr/blog/litiges-en-copropriete/
[9] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736